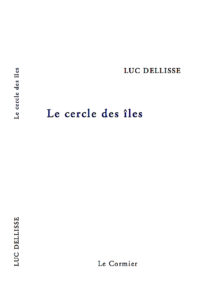 Texte de Luc Dellisse
Texte de Luc Dellisse
Dessins de Souad Azar
Les voiles se sont posées sur la croisée des villes
Au-dessus des moulins, de voitures aux hublots
Couverts d’embruns, ancre rouillée en bandoulière
Au-dessus des maisons en poudre de calcaire
Au-dessus des cafés, sang bleu des navires échoués
Velum rayé à contre-sens du vent
Cliquetis de la mante repliée dans ses songes
Tous ses amants sont morts. Je suis seul et vivant.
Le Cormier, 2020
106 pages / 14×21 / ISBN 978-2-875980-24-3 Prix: 18 euros
325 exemplaires sur Rives dont 25 exemplaires de tête accompagnés d’un dessin original de Souad Azar, numérotés et signés.
Extraits de presse
“Le cercle des îles” de Luc Dellisse
L’île de Porquerolles constitua pour Luc Dellisse, enfant, la révélation de son insularité , de sa passion des îles, de leur destination à être le lieu idéal de l’écrivain. L’année de ses onze ans il découvre que cette sensation invincible, immortelle, d’échapper à la pesanteur de l’âme, ne ressemble à rien d’autre qu’à la joie pure.
Aujourd’hui, l’écrivain que nous avons rencontré souvent au détour d’une bibliographie multiple de romancier, essayiste, nouvelliste, qu’il renouvelle continûment, nous donne une des clés de son oeuvre: La poésie est la seul chose qui me relie (…) à la passion des îles. C’est dire combien ce recueil, paru chez Le Cormier, constitue un indispensable archipel constitué ici de huit paysages poétiques, en prose et en vers réguliers, au coeur duquel nous invite Luc Dellisse.
Il n’est pas de recension objective d’une oeuvre. On ne peut qu’en proposer les fragments qu’elle dépose, une fois la lecture achevée, dans cette mémoire partagée dorénavant avec le texte, avec l’écriture singulière de celui qui fixe pour nous le cap idéal du grand vaisseau terrestre , cette île, ces îles dont il est l’amiral.
Il y a l’enfance, Enfance remuée sous les brasses , l’éveil de la sensualité, ce « Point de départ » des premiers émois: Pâleur, rougeur, courbe des seins / Et la demeure d’un instant fatidique. Mais aussi ces fragments d’un passé singulier qui nous semblent familiers car la poésie fait d’eux d’universelles mémoires éveillant les nôtres, loin de « Port-Gros » , hors de l’ »Album », pourtant si proches qu’on les croit nôtres Le dernier jour avant la mouette aux bagages/On regardait le vent, la piste d’or gris/Le cirque dont nous étions les singes-acrobates/Le dernier coup de balançoire dans l’arrière cour/ L’amour aura toujours un goût de Nivea.
Mais il faut laisser l’enfance, et se retrouver « Hors d’atteinte » et pourtant si vulnérable adulte. Est-ce d’une rencontre, d’un amour et d’une séparation que nous parlent les douze poèmes réunis sous ce titre en forme de fuite? Est-ce une allégorie de l’éloignement des îles, de l’abandon des éblouissements de l’enfance? Peu importe…puisque le texte nous appartient dorénavant et qu’il nous dit aujourd’hui ce qu’il dissimulera demain quand nous ouvrirons à nouveau le recueil et que, le hasard nous donnera en première escale ces vers: Le crayon bleu aux arêtes tranchantes/Dont la pointe mordue fléchit en écrivant/Ferme une à une les lampes meurtrières/ Je reste ici dans le néant de la lumière.
Allons, dans le sillage du poète, qui choisit dorénavant le rythme de la prose, « Du côté du ponant », explorer d’autres sites auxquels il dédie le tracé bleu de son crayon. « Vauban », « Abysses », « Belvédère », « escale », « Piège », « Echecs » , « Soute », « Quarantaine », « Rue coupée net », « Bateau noir », « La fin des îles » et enfin « Le pacte » sont autant de fenêtres auxquelles le poète appuie le front, laissant venir à lui les apparitions mémorielles au coeur desquelles il s’insinue pour les retenir. Ainsi surgissent les îles grecques (« Vauban »), l’immense bouffée de mémoire sensuelle (« Abysses »), et cet inconnu qui durant sa si longue carrière de tricheur, aux yeux pleins d’absinthe et de saphir, (…) a mêlé l’humain à l’inhumain comme on bat et rebat les cartes, à sa manière robuste du survivant du désastre glaciaire (« Escale »).
La clé de ce recueil, s’il faut en proposer une, se trouve peut-être sous le titre polysémique d’un des récits en prose, disposé au milieu de la lecture, comme une étape dans l’incertaine navigation. Dans ces « Echecs », une phrase déplie cet instant de vérité, comme une aspiration du poète surpris par la page et les barbelés d’encre qui s’y déploient, empêchant l’accès mais laissant visible, lisible ce dont ils nous séparent: Tout était suspendu au fil de l’encre qui se déroulait comme un rêve. Il n’y avait aucun mensonge ce soir-là. Une étonnante et fragile liberté naissait de chaque mot. C’était le premier jour du monde, une fois de plus. (« Echecs »)
Et puis, il y a au fil des pages, la vibration incessante de ce qu’a peut-être créé, aux commencements, la nécessité de l’île, de sa joie, de sa vie: l’amour sans cesse renouvelé qui nourrit l’injonction qui clôt le livre: Ô ma lointaine mer. Ô mes amours du flux et du reflux. Ô mon désir de vivre insatiable. Ô mon bateau blanc si fragile bondissant au-dessus des vagues, comme jaillissant de l’orage des nerfs.
Aujourd’hui nous dit le poète je vis sans les îles. La vie y est faite pour les célibataires amoureux et je n’aime plus qu’une seule femme.
Terminons avec lui cette navigation, fermons le livre et appuyons notre front à la vitre. Nous y retournerons à ce livre, relire les pages consacrées à Istanbul, Manhattan, Athènes, mais aussi, lors du « Retour dans l’île », les lieux de Sicle: Syracuse, Messine, Agrigente, Trapani, Castelvetrano… car les noms de lieux sont aussi poésie, n’est-ce pas?
Cette poésie dont Dellisse nous propose cette formulation idéale: un état du regard qui modifie la lumière du monde…
Nous avions évoqué par des articles ou interviews différents ouvrages de Luc Dellisse. On peut les retrouver en cliquant sur les liens ci-dessous:
« Le tombeau d’une amitié » / « Ciel ouvert » / « Libre comme Robinson » /« L’amour et puis rien »
Jean Jauniaux, L’ivresse des livres, 25 octobre 2020
Luc Dellisse, homme libre, toujours…
Un double mouvement, systole-diastole, semble bercer toute l’œuvre de Luc Dellisse. Sans la contraindre à une programmation rigide, l’auteur lui infléchit – consciemment ou non ? – une rythmique plus proche du pneuma que de ladunamis… Publier donc un essai, puis un recueil de nouvelles, un essai encore, puis un recueil de poèmes, témoigne à la fois d’un vitalisme pulsatile, profond, ainsi que d’une cohérence insoumise à tout, si ce n’est à l’impératif de liberté grande.
Voici qu’on ouvre, ou plutôt que s’ouvre à nous, Le cercle des îles. Le motif n’est-il pas éculé, depuis que Rimbaud lança sur les flots son bateau ivre ? Dellisse n’avait-il pas épuisé la topique dans un récent essai placé sous le signe de Robinson ? En des temps où l’on vous demande, et en uniforme encore, des comptes si vous circulez dans une commune où vous n’êtes pas domicilié, n’est-il pas quelque peu sadique de faire miroiter d’inaccessibles lointains ? Et puisqu’il paraît que chacun de nous en est une, d’île, à quoi bon explorer celles des autres, fussent-elles les dominions de quelque poète inspiré ? C’est qu’ici, le périple est tout intérieur. Si le corps se cantonne dans une certaine sédentarité, l’âme se réserve le souverain privilège du nomadisme.
Aucun des tropiques qu’elle longe n’est triste – car Dellisse est de ceux qui savent que, des larmes comme de l’eau de mer, il ne faut retenir que le sel –, mais empreint avec justesse d’une nostalgie maîtrisée, sans apitoiement sur soi ni sur le monde ancien, qui à chaque jour s’engloutit. Pas de « voyage » non plus dans ces pages, mais de capricieuses circumnavigations qui épousent une mémoire fugitive et riche d’un très long cours.
L’insomnie guette qui se lance dans une telle odyssée silencieuse, mais c’est pour mieux se retrouver, se situer… « Se réveiller au milieu de la nuit, et savoir aussitôt où l’on est : dans le cercle ». L’ancre peut être jetée dans des baies ou des criques réelles auxquelles on accosta jadis ; le paysage demeure celui que les impressions, les sensations, consentent à réinventer à chaque encablure de conquise. Au fil de ces textes, les images se filent et s’enchaînent, de façon très cinématographique, comme si Dellisse, inversant le principe esthétique de la Nouvelle vague, créait le stylo-caméra. Les visions ne surgissent pas, elles s’imposent comme autant d’évidences, prises dans les mailles d’une sémantique à dominante marine, aux liquidités sensuelles.
Dellisse aime ainsi le sang qui sourd des baisers, dont il savoure chaque morsure quand une présence l’accompagne un peu. Mais à tout prendre, il préfère la fréquentation des « hauts geysers de solitude / [qui] s’accrochent à nos rayons de leurs lèvres bifides / Et provoquent au dessus du vide / Le simulacre des regrets. »
Est-ce là être utile à la société ?, s’interroge Dellisse, comme s’il anticipait avec lucidité le procès intenté depuis des siècles au poète… Le ton, pour une fois, se fait péremptoire : « Il est utile. Il rend des services incompréhensibles au monde ordinaire, mais dont les effets éventent, bouleversent, réorganisent les cales, le ponton, l’équipage, les passagers, les couloirs, le ciel. Ses yeux de faux aveugle voient tout ce qui est durée ». Voilà en quoi la littérature sert à tous, sans servir quiconque. Elle sert à rappeler aussi que, pour l’écrivain authentique, chaque phrase signe un crucial passage de la ligne. Les horizons qu’il nous désigne peuvent se quitter des yeux, pas de l’esprit, et jamais du cœur.
Frédéric Saenen, Le Carnet et les Instants, 1er décembre 2020
Un livre un extrait (18), Le Cercle des îles de Luc Dellisse
Accablé par la mer
L’hôtel de la falaise s’enfonce dans la craie
C’est la rupture avec le printemps éternel
On relève les lignes
Il n’est parfois plus temps de labourer la nuit
Il faut rêver debout dans la bourrasque
Les îles se font obsession et l’eau s’infiltre partout dans le réel. Même à l’intérieur des terres, la mer envahit le monde que les mots liquéfient.
Au-dessus des moulins, de voitures aux hublots
Couverts d’embruns, ancre rouillée en bandoulière
Au-dessus des maisons en poudre de calcaire
Au-dessus des cafés, sang bleu des navires échoués
Velum rayé à contre-sens du vent
Cliquetis de la mante repliée dans ses songes
Tous ses amants sont morts. Je suis seul et vivant.
Stéphanie Moors, Karoo, 21 décembre 2020
Luc DELLISSE, Le cercle des îles, Le cormier, Bruxelles, 2020, 98 pages.

Une deuxième salve, après celle de décembre 2020. J’ai choisi cette fois le texte 3 de Retour dans l’île, Une mémoire sicilienne (page 72) :
« Les matins écrasés dans le poing de la vigne
Ont laissé un pollen transparent dans l’air
Vertige remontant les créneaux de la
Paresse et gagnant le large
Et je reprends l’oiseau, le sillage des nerfs
J’appuie mes yeux sur le hublot
Je touche avec mon sang
Les trois pointes du regard. »
Philippe Remy-Wilkin, Les belles phrases, 30 mai 2021.


