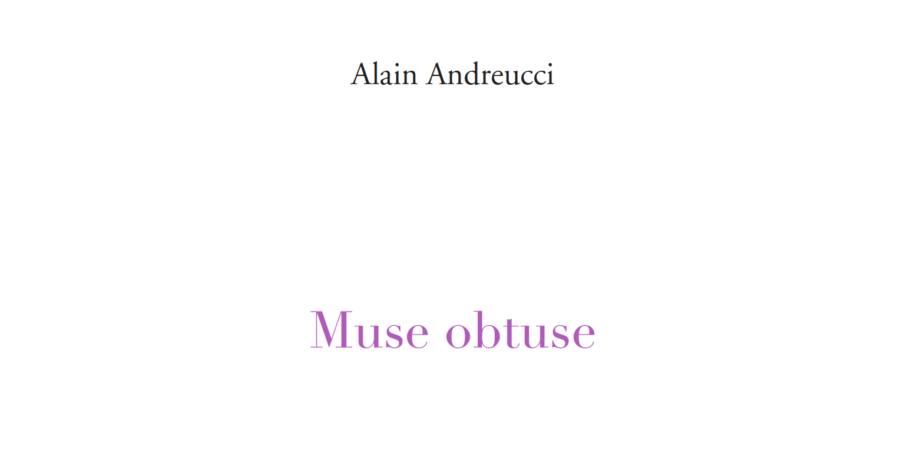Alain ANDREUCCI, Muse obtuse (Le Cormier, 18 €)
Que serait – mieux que qui – cette « Muse obtuse » ? S’agit-il, comme semble le dire le premier poème d’une muse à la fois « Ligotée dans les grosses ficelles du monde » – en conséquence elle ne serait pas responsable de son caractère obtus – et « casquée. / Dans [sa] camisole de cauchemar, nimbée. / De l’auréole des saintes de travers ». Le poète viendrait faire amende honorable en abandonnant « l’automne tonitruant des phrases » et « une jeunesse qui ouvrait et fermait allègrement le portail de la poésie » et sans avoir honte du vers ancien ouvrirait une nouvelle page, celle de « l’âge mur » qui bride « d’un cran » la paupière du vers.
Il semble que dans ce livre de poèmes – mieux que recueil car il ne s’agit pas de recueillir ou de rassembler ici des poèmes épars mais de suivre le fil d’une pensée – chantent à la fois un désenchantement total du monde (amour, vieillesse, poésie, …) et son ré-enchantement par le moyen même qui l’aurait accompagné dans sa destruction, le poème. Le poète est peut-être ce « Bel endormi » qui se croyait « bouche cousue définitive ». Aussi interroge-t-il ce qui le fait revenir en langue comme en jambe et enjambements barrés par le point. Sa marque de fabrique, qui peut alors s’interpréter à nouveaux frais comme l’arrêt au bord du précipice d’un vers qui risque d’engloutir le vers pour oser défrayer la chronique en démantelant « La bienséante prosodie. / Qui en prostituée viendrait ici se délier. / Des charmes d’un vautour d’une mésange d’un rossignol ? »
Le poète chante un peu une vie qui « s’épuise » et espère pour « la diction sempiternelle » une forme de même sort : comme la vie, puisse-t-elle s’épuiser celle qui « semble n’avoir jamais pitié de nous lorsque nous sommes devenus. / Ses égarés ».
Et tu es là morte à ne rien parler que je comprenne en vérité.
Où chaque chose du vivant cependant continue de porter son nom d’écrou. Son nom d’octroi son nom de chose calfaté.
Ligotée que tu es dans les grosses ficelles du monde.
On ne sait si le discours du poète s’adresse uniquement à la muse ou s’il s’adresse également, selon une séparation encore floue de l’une et de l’autre, à la femme aimée, morte aujourd’hui mais que l’on appelle comme muse. En effet, la muse n’est pas morte à cet instant de ce long poème qui ne s’achèvera plus. Mais le poète avertit : « Ne te hâte pas ce que. / Tu poses nulle ignorance ne viendra pour l’éclairer encore moins. »
Toutefois, la « mendiante bègue », l’écriture, se manifeste. Et elle porte « le chevreau d’une voix », peut-être une voix qui chevrote, qui hésite, qui s’essaie, qui cherche son « métronome du cœur battant battu où nul n’est ciel ». Ce cœur est-il « un cœur sec de ce sang » dont « l’estropié du monde bruyant » se réclame, l’estropié pouvant représenter à la fois ce qui de ce monde est estropié ou le poète lui-même, le poète avec sa « langue inexacte ».
« De stupeurs dont nous sommes tissés envers endroit », la « langue d’engrenage » du poème permet de négocier « le sens et le vide » pour entrer dans la nuit verte comme le pré » dans l’espérance du poème.
Il faut encore compter avec un paradoxe entre « muse obtuse » et « méduse » : « Le beau était c’était on ne savait pas encore. / Que les lanières de la poésie comme d’une méduse. / Avaient d’ores lacé poumons visages enfers dans leur corset. / Jusqu’à la voix qui entonnait dans l’entonnoir. »
Avec Muse obtuse s’exprime un renouveau dans une énonciation qui épanouit l’énergie de l’union des contraires. Ainsi, par exemple, de cette expression frappante « placenta de deuil » qui dit une gestation du poème qui n’oublie pas que celle-ci se fait sur des ruines anciennes : « Sans doute Muse portais-tu en toi comme une accouchée. / Sous placenta de deuil un deuil qui te disait : gloire à l’oubli gloire. / À ce qui disparaît […] » Sont liées ici mort et naissance, comme si l’oubli n’était qu’une forme de mort sur laquelle bâtir dès le deuil.
Ce renouveau se fait d’abord sentir par un « feu d’entrailles » comme lave. La Muse se transforme en « vestale du volcan ». Elle se fait gardienne d’une entité double, une voix qui porte en elle une présence qui n’oublie pas. Une telle voix, voix mourante/naissante du paradoxe, est l’avenir du poème alors que le poète se croyait « dénudé d’avenir ».
Entre acte chirurgical qui demande ligature et maléfice de sorcellerie contre lequel il faut trouver la formule qui désenvoûte ou l’antidote qui guérit, écrire oscille entre le doute et l’affirmation et quitte la sensation d’être insignifiant ou insuffisant. En agissant ainsi, le poète sort peu à peu d’une culpabilité qui était un empêchement au poème. « S’est retourné l’esclave qui tu fus. / Dans son soleil de chaînes ».
Enfin, ce nouvel opus d’Alain Andreucci est une promesse, celle de revenir au poème, celle de l’avenir du poème, en faisant appel à cette muse incertaine, malgré le deuil, malgré le monde, malgré. Peut-être est-il également un tombeau à l’aimée.
Régis Lefort